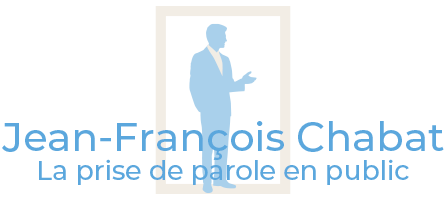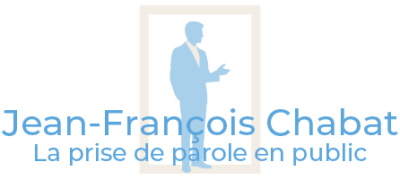La diction, qui englobe l’articulation et la prononciation, est essentielle pour assurer une communication efficace. Elle pourrait se définir comme l’art de bien dire les mots. Et donc celui de se faire bien comprendre.
Une étude publiée en 1995 par deux chercheurs du CNRS spécialistes en linguistique, Lacoste et Gardin (1), une diction soignée, outre qu’elle renforce l’impact d’une présentation, est toujours perçue comme un signe de professionnalisme et de confiance en soi.
L’articulation, élément clé de la diction, fait référence à la formation des sons à l’aide des organes de la parole tels que la langue, les lèvres et la mâchoire. C’est pour faire simple, l’art de bien dire les consonnes. Une articulation claire permet de rendre chaque son bien distinct, ce qui est crucial pour éviter des malentendus.
La prononciation désigne l’art de bien dire les voyelles. Pas trop de problèmes, dans la langue française en tout cas. On va prononcer le « o » (gâteau) comme un « ô » (port) dans la région toulousaine, mais rien là-dedans qui n’entrave la compréhension, juste un accent charmant.
Pour améliorer sa diction, plusieurs exercices peuvent être mis en pratique.
La lecture à voix haute, la répétition de phrases complexes et les exercices de diction comme les virelangues sont faits pour ça.
Jacqueline Maillant faisait vingt « X-O » tous les soirs avant de rentrer en scène. Vingt ! Pas cinq ! 💪
Charles Dullin, un des plus grand metteur en scène du XXème siècle, recommandait à ses élèves de visionner un cheval, dont les jambes de devant seraient les consonnes et celles de derrière les voyelles. Si les jambes de devant courent, celles de derrière suivent. Donc, j’appuie sur les consonnes, les voyelles je ne m’en préoccupe pas, elles suivront d’elles mêmes.
Dans « Bonjour, ça va ? », insistez sur le « b », « j », « r » « s », « v ». Les « on », « ou », « a », « a » suivront. Deux fois moins de boulot au final.
Travailler sa diction est un investissement précieux pour ceux qui souhaitent communiquer avec clarté.
Un bon moyen de passer de l’orateur hésitant au maestro de la parole.
Références :
Langages, 29ᵉ année, n°117, 1995. Les analyses du discours en France. Article de Bernard Gardin et Véronique Lacoste
« Discours en situation de travail », pp. 12-31